Le point dominical du Docteur MAD
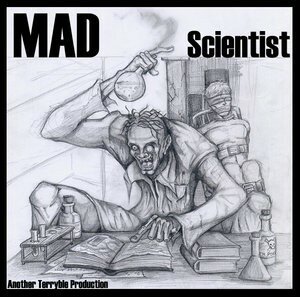
...Considérée encore au XIXe siècle comme un simple symptôme, la dépression est aujourd'hui devenue à la fois une entité clinique à part entière et, remplaçant la névrose, le trouble mental le plus répandu dans le monde occidental. C'est donc une nouvelle maladie de civilisation. Elle se nourrit de tous les malheurs sociaux, de toutes les misères, de toutes les exclusions, mais tout autant de l'absence de repères, de la disparition du sens. Alliant l'ancienne mélancolique aristocratique à l'égalité démocratique, elle correspond à un horizon d'attente perpétuellement déçu. Plus encore qu'un état, elle est une façon de nommer des problèmes engendrés par le monde contemporain. C'est dans cette acception qu'il est permis de parler de société dépressive.
Si la dépression a pris aujourd'hui une telle extension, c'est d'abord parce que nous sommes devenus des individus, sans aucune tradition ni aucun repère pour nous indiquer du dehors qui nous devons être et comment nous devons nous conduire. Alain Ehrenberg l'a bien montré, libération de l'individu et insécurité identitaire chronique sont deux faces d'une même dynamique. La dépression est une maladie de la liberté moderne, qui accompagne et sanctionne la montée de la référence à l'autonomie individuelle dans la vie sociale. Confronté à la claire conscience de sa finitude, l'homme ne peut vivre qu'en créant dans le monde son propre monde, un monde assorti de repères et constituant la somme des possibilités d'être qui s'offrent à lui. Devenu autonome, l'individu s'aperçoit trop souvent qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait ou de ce qu'il a acquis. Il n'est pas même à la hauteur de ses désirs. Affranchi des anciens systèmes de conformité ou d'obéissance, il ne parvient pas à se doter lui-même des repères nécessaires pour les remplacer.
Dans une société où chacun est censé être son propre souverain, l'individu se trouve moins confronté à la question de l'interdit - qui ne disparaît pas, loin de là, mais prend des formes plus subtiles - qu'à celle de la possibilité illimitée. Or, le déchaînement de la technoscience et le déploiement planétaire de la Forme-Capital nous ont fait entrer dans l'ère de l'illimité. Ce refus des limites est aussi un refus de tout repère, car un repère n'oriente qu'en instituant des limites. Un repère, quel qu'il soit, permet de comprendre que tout n'est pas possible - ou que tout ce qui est virtuellement possible n'est pas pour autant souhaitable. De ce point de vue, le principe de plaisir s'oppose plus que jamais au principe de réalité, d'autant que le virtuel dévalue le réel jusqu'à prendre sa place. Le malaise provient alors de l'incapacité à faire face à des impulsions contradictoires dans une société qui pousse tout un chacun à « s'épanouir » après avoir pris soin de s'assurer d'abord de son conformisme, et à jouir de sa « liberté » tout en mettant en place des procédures de contrôle toujours plus élaborées. L'homme se découvre chaque jour plus vulnérable et fragile dans un monde qui, dans le même temps, lui enjoint d'être toujours plus « performant ». Il mesure alors son besoin d'être. Il déprime.
Mais la perte de repères se nourrit aussi de l'absence d'espérances. Après les échecs et les horreurs du XXe siècle, nos contemporains se sont résignés à vivre sous l'horizon de la fatalité. Le grand message du néolibéralisme, constamment relayé par les médias, est qu'il n'y a pas d'alternative au statu quo. Cette société est désespérante ? Il n'y en a pas d'autre possible. Alors, plus que jamais, tout change pour que rien ne change. Nous vivons ainsi à la fois sous l'horizon de l'illimité - l'infinité de la marchandise - et dans la perspective exiguë d'une histoire achevée, où l'omniprésente distraction, au sens pascalien du terme, a pour seul but de masquer le vide et l'ennui, le sentiment de perte irréparable qui nourrit les mélancolies. Nous vivons à la fois dans le mouvement perpétuel et dans le sur-place, dans le trop plein et dans le trop vide. À la fois dans l'idée que tout est possible, et dans le constat que rien ne peut être maîtrisé.
Le rapport au temps, du même coup, se transforme. Le passé n'est plus « historicisable », mais hystérisé de manière narcissique ou obsessionnelle. Le présent n'est plus « futurisable » : il ne peut plus se projeter dans l'avenir autrement que comme répétition pure. L'avenir, enfin, est perçu avant tout comme porteur de menaces, et non plus de promesses. Les ferveurs sacrificielles, les mobilisations inouïes du XXe siècle, peuvent bien entretenir les commémorations compulsives d'une « mémoire » qui tourne à vide, elles ne peuvent rétrospectivement susciter que l'incompréhension (comment imaginer que l'on puisse mourir pour une cause ou faire le don de soi dans un monde où rien n'est gratuit ?) et laisser la place à la gestion prudente des intérêts.
Menaces et risques de toutes sortes semblent se multiplier au moment même où le risque collectif n'est plus accepté, mais regardé comme un scandale (à commencer par le risque maximal qu'est la mort). En résultent des peurs incontrôlables, qui engendrent autant de fantasmes. À l'ère de la victimologie, tout malheur est vécu comme une catastrophe, mais on ne propose que des solutions individuelles (l'« assistance psychologique ») aux malheurs sociaux. On ne sait plus alors ce que c'est que vivre, on cherche seulement à survivre à tout prix. La vogue du langage des « droits » exprime le désir d'être statutairement garanti contre tout. Mais ce désir est impossible à satisfaire. L'obsession de la sécurité s'accentuera encore avec le vieillissement de la population.
Le lent processus de désenchantement du monde - par la théologie d'abord, par la science ensuite - arrive à son terme. La transformation du monde en marché dessine un univers où tout s'évalue en termes comptables, où la Forme-Capital étend peu à peu ses critères d'évaluation à tous les domaines de la vie sociale. Ce n'est plus l'homme qui est la mesure de toutes choses, mais les choses produites et échangées qui deviennent la mesure de l'homme. Tout ce qui faisait sens, tout ce qui comportait une dimension symbolique propre à aider l'imaginaire à se soutenir lui-même, est en voie d'éradication dans un monde où l'homme et la nature sont eux-mêmes de plus en plus exclus. Cette mise en coupe réglée du monde par le capitalisme et l'idéologie occidentale de la maîtrise totale contribue elle aussi à la généralisation du non-sens.
Comme la chute de la natalité, la dépression révèle un défaut de vitalité - comme si tout ce que les générations antérieures avaient apporté, avait du même coup épuisé les suivantes. Que les sociétés les plus riches soient aussi les sociétés les plus dépressives montre bien que l'argent ne fait pas le bonheur et que la joie de vivre n'est pas une affaire de niveau de vie matériel ou de pouvoir d'achat. Les sociétés matériellement les plus riches sont aujourd'hui aussi les plus pauvres du point de vue spirituel, tandis que les plus pauvres matériellement peuvent encore s'appuyer sur le passé et garder foi en l'avenir. Il y avait autrefois un lien direct entre le désespoir (individuel) et l'explosion (sociale). Il y en a un aujourd'hui entre la dépression et l'implosion.
Ce monde, un jour, implosera.




/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F71%2F356266%2F94511774_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F0%2F201375.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F20%2F356266%2F40175175_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F50%2F356266%2F19017111_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F21%2F356266%2F17875874_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F23%2F356266%2F17397935_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F88%2F356266%2F17204399_o.jpg)